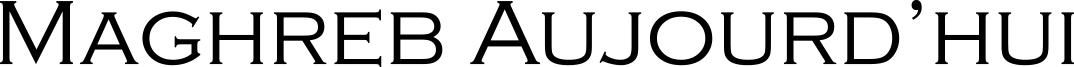Le dernier cycle d’affrontements israélo-palestiniens, du 10 au 21 mai, a coûté la vie à 273 Palestiniens (dont 25 en Cisjordanie) et à 12 Israéliens. Pour les deux millions de femmes et d’hommes de la bande de Gaza, assiégée depuis quinze ans, c’est une nouvelle tragédie, qui aggrave les traumatismes des guerres de 2008-09, 2012 et 2014. Le « cauchemar dans le cauchemar » des bombardements israéliens d’une population déjà sous la botte du Hamas se poursuit, sans aucun espoir d’issue. « S’il y a un enfer sur terre, c’est la vie des enfants de Gaza« , a même déclaré le secrétaire général de l’ONU. Une fois rappelée cette terrible réalité, force est de constater que la crise a accentué certains rapports de force régionaux et internationaux, entre « gagnants » et « perdants ».
LES TROIS GRANDS GAGNANTS
Benyamin Nétanyahou n’était plus, en milieu de journée du 10 mai, qu’un Premier ministre en sursis, incapable de former un nouveau gouvernement, sous le coup d’une triple mise en examen pour fraude, corruption et abus de confiance. En outre, la mobilisation pacifique des Palestiniens de Jérusalem-Est venait de lui infliger une cinglante humiliation, avec l’annulation des célébrations israéliennes de la « réunification » de la Ville sainte. C’est alors que les salves de roquettes, tirées depuis la bande de Gaza par le Hamas et ses alliés, ont permis à Nétanyahou de retrouver son rôle de prédilection : celui du défenseur intransigeant de la sécurité d’Israël, face aux « terroristes » bien entendu, mais aussi face à toute forme d’intervention extérieure, qu’elle soit diplomatique, humanitaire ou médiatique. La base inconditionnelle du Premier ministre a ainsi applaudi aux bombardements des bureaux des médias étrangers à Gaza, sans qu’aucune preuve de la présence du Hamas dans les sites visés n’ait été avancée.
Le Hamas a décidé, avec un absolu cynisme, de détourner à son profit la victoire symbolique des manifestants de Jérusalem-Est, en se posant en « défenseur » de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam. Il a ainsi capitalisé sur l’immense émotion suscitée dans la population palestinienne par une intervention israélienne jugée d’autant plus choquante qu’elle se déroulait durant le mois sacré de Ramadan. Il a marginalisé Mahmoud Abbas et son Autorité palestinienne, qui avaient cru perpétuer leur contrôle d’une partie de la Cisjordanie en repoussant sine die les élections législatives prévues ce 22 mai. Comme toujours depuis sa fondation en 1987, le mouvement islamiste a privilégié ses intérêts de parti sur ceux de la population, considérant que ses militants seraient mieux protégés que les simples civils des inévitables représailles israéliennes. Un pari que la brutalité de Nétanyahou rend malheureusement gagnant.
Recep Tayyip Erdogan a réussi à s’afficher en champion le plus virulent d’un monde islamique « agressé » par l’intervention d’Israël dans la mosquée Al-Aqsa, puis par ses bombardements sur la bande de Gaza. Déjà en 2009, ses critiques de l’offensive israélienne sur Gaza, qui contrastaient avec le silence embarrassé de ses pairs arabes, lui avaient valu une immense popularité en Turquie et à l’étranger. Il avait renouvelé un telle opération de récupération à l’automne dernier, après les déclarations d’Emmanuel Macron sur les « caricatures » du prophète Mohammed. Cette posture de combat, souvent outrancière, permet au président turc d’engranger des soutiens qui vont bien au-delà de sa base islamiste, rendant inaudible le discours pourtant d’une rare fermeté de l’Arabie saoudite.
LES TROIS GRANDS PERDANTS
Joe Biden sort affaibli de sa première crise diplomatique. Alors que le monde entier attendait de lui la restauration d’un multilatéralisme bien malmené par Donald Trump, le nouveau président américain a prétendu conserver la haute main sur le dossier israélo-palestinien, mais a attendu neuf longs jours avant d’appeler à une simple « désescalade ». Ce mélange délétère d’unilatéralisme et de passivité n’a pu qu’encourager la poursuite des hostilités, marginaliser les « modérés » dans la région et humilier un peu plus l’ONU, dont les Etats-Unis ont bloqué toute expression collective durant l’ensemble de la crise. Washington a même menacé en coulisses d’opposer son veto, au Conseil de sécurité, à une résolution de la France appelant à un cessez-le-feu. Que Biden reste marqué par l’échec amer des interventions d’Obama sur ce dossier est une chose, qu’il ait prouvé son incapacité à adopter une nouvelle approche, plus ouverte à l’égard de ses alliés, en est une autre, à l’impact négatif désormais incontestable.
L’Union européenne est apparue divisée, impuissante et réduite à un statut de spectateur, face à un conflit aux retombées pourtant multiples sur son sol. Elle paie ainsi sa très grave erreur d’avoir accepté, le mois dernier, le sabotage par Abbas du processus électoral palestinien. Premier bailleur de fonds de l’Autorité palestinienne, elle aurait pu imposer à Abbas de remettre enfin en jeu son mandat, arrivé à échéance en 2010. Elle aurait favorisé, avec la tenue des premières législatives depuis 2006, la politisation des formations palestiniennes plutôt que leur militarisation. Au moment où le désengagement des Etats-Unis offre une opportunité historique à l’UE au Moyen-Orient, elle n’a réuni ses ministres des Affaires étrangères que huit longs jours après le début du conflit. Et même le communiqué insipide adopté à cette occasion a été dénoncé par la Hongrie, prouvant que l’UE perd tout à s’aligner vers le bas et gagnerait sans doute à projeter, au contraire, une vision d’avenir pour Israël et la Palestine.
Les Emirats arabes unis ont démontré que leur traité de paix de septembre dernier avec Israël était purement bilatéral et n’aurait aucun impact positif sur la question palestinienne. Le « nouveau Moyen-Orient » que les « accords d’Abraham », conclus également avec Bahreïn, le Maroc et le Soudan, étaient censés promouvoir s’est avéré une simple opération de communication. A l’heure du dur rappel à la réalité, Abou Dhabi a dû laisser la médiation entre les belligérants à l’Egypte et à la Jordanie, les deux pays arabes à qui leur propre traité de paix avec Israël n’interdit pas les relations avec le Hamas. La normalisation israélo-arabe, au mieux, ne fait pas progresser le règlement du conflit israélo-palestinien et, au pire, ne fait que l’aggraver. C’est peut-être une des leçons les plus sévères de la crise encore en cours à Gaza. Car, comme le souligne Alain Frachon dans « Le Monde », « le temps est venu d’internationaliser la question palestinienne ».
Source : Le Monde