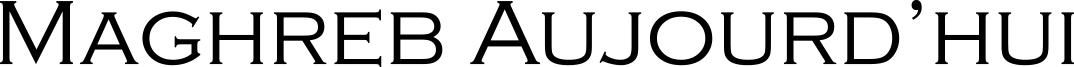Le 30 avril 2025, le Kremlin a de nouveau déclaré sa volonté d’engager des négociations avec l’Ukraine. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a annoncé que Moscou était ouverte au dialogue sans conditions préalables, tout en insistant pour que les négociations aient lieu directement avec Kyiv, et non via Washington. Cette déclaration intervient dans le contexte d'une proposition russe d'une trêve de trois jours, du 8 au 10 mai, à l’occasion des célébrations de la Journée de la Victoire.
La réaction ukrainienne a été prudente. Dans son allocution du 30 avril, le président Volodymyr Zelensky a qualifié cette initiative de « manipulation », en soulignant : « Il n’est pas nécessaire d’attendre le 8 mai pour arrêter la guerre. Il faut cesser les frappes, cesser les meurtres – et ensuite chercher une solution par la négociation ». Cette position reflète l’exigence constante de Kyiv : pas de négociations sans arrêt complet des hostilités par la Russie.
Parallèlement, les initiatives diplomatiques américaines progressent. L’envoyé spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, a annoncé que l’Ukraine avait accepté, la semaine dernière à Londres, 22 points d’un plan d’action proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Kellogg a précisé que les discussions avec Kyiv se déroulaient dans un esprit de partenariat, et que « c’est désormais à la Russie de jouer ». Il a également critiqué la proposition de trêve de trois jours, la qualifiant « d’insuffisante et tactique ».
En outre, les États-Unis ont annoncé leur première exportation directe d’armes vers l’Ukraine sous l’administration Trump, pour un montant de 50 millions de dollars. Cette annonce a coïncidé avec la signature d’un nouvel accord stratégique entre les États-Unis et l’Ukraine, concernant un fonds commun de développement dans le secteur des ressources minérales. L’accord prévoit des investissements des deux pays dans des projets situés sur le territoire ukrainien – de l’extraction jusqu’aux infrastructures – avec un réinvestissement des bénéfices dans la reconstruction du pays durant les dix premières années. Ainsi, les États-Unis soutiennent non seulement la relance économique, mais affirment aussi leur rôle dans l’architecture sécuritaire de la région à long terme.
Selon certains observateurs occidentaux, ces actions montrent que Washington est prêt à s'engager non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans politique et économique. C’est un signal que les États-Unis considèrent l’Ukraine comme un partenaire durable, et non comme un simple bénéficiaire temporaire de l’aide. Cela envoie aussi un message à Moscou : prolonger le conflit ne changera pas la position globale de l’Occident en faveur de Kyiv.
Dans ce contexte, le sénateur républicain Lindsey Graham, un proche allié du président Trump, a présenté au Congrès un projet de loi intitulé Sanctioning Russia Act of 2025, prévoyant des sanctions maximales contre la Russie et des droits de douane de 500 % sur les importations de pays achetant du pétrole, du gaz, de l’uranium ou d’autres ressources russes. Selon Graham, le projet de loi bénéficie déjà du soutien de 72 sénateurs, ce qui permettrait de surmonter un éventuel veto présidentiel. Il a souligné que ces mesures visaient à faire pression sur Moscou pour parvenir à la paix, mais constituaient aussi un avertissement : sans progrès, l’économie russe subira un coup sévère.
Pendant ce temps, la Russie continue ses opérations militaires. Ces dernières semaines, plusieurs villes ukrainiennes ont été la cible de bombardements massifs, ce qui remet en question la sincérité des intentions russes de mettre fin à la guerre. Le 29 avril, la Russie a mené une nouvelle attaque de drones sur la ville de Soumy, faisant des victimes civiles. Ces actes sapent la confiance dans les déclarations de paix du Kremlin et poussent les partenaires occidentaux à considérer les initiatives russes comme des manœuvres diplomatiques plutôt que comme des efforts réels de résolution.
Dans ce contexte, une question centrale se pose : les déclarations de Moscou sur sa volonté de paix font-elles partie d’une manœuvre diplomatique ou annoncent-elles de véritables négociations ? Compte tenu de la simultanéité des appels au dialogue et de la poursuite des bombardements, les partenaires occidentaux doivent faire preuve de prudence. Toute résolution pacifique doit être fondée sur le respect du droit international, et non sur la consolidation des résultats de l’agression.
Une paix durable exige non seulement un cessez-le-feu, mais aussi une responsabilité claire en cas de violations. Ce n’est que sur cette base que la confiance dans le dialogue comme outil de résolution des conflits en Europe pourra être restaurée.
Source: interregionews.eu