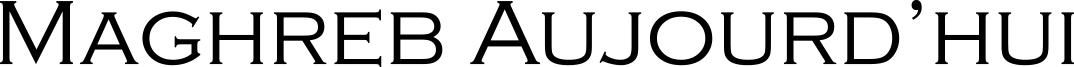« L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. L’Etat garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité », dispose l’article 44 de la nouvelle Constitution tunisienne de 2022. Ce discours-loi pur produit du régime de vérité de l’État tunisien, se veut un comble de nature, qui va de soi, une doxa, dont tout extérieur (pensée critique ou l’hérésie intellectuelle) est relégué au rang de marge. Cet ordre du discours est un marqueur de l’idéologie dominante qui a perpétué, au prix d’une « violence symbolique », le récit de l’État-nation tunisien sur le rôle substantiel de l’enseignement public dans la construction de l’État moderne au sortir du colonialisme français, son développement et sa pérennité.
« Mérite », « égalité des chances », « gratuité et qualité de l’instruction », « ascenseur social », sont les leitmotivs de l’agencement collectif d’énonciation de l’État tunisien, qui est en dernière instance son agencement social. Or pour distancier cet ordre du discours, déranger l’ordre lié de ses phrases et interroger le pouvoir sur ses discours de vérités, on se doit de le ramener à la dure réalité de la formation sociale tunisienne : plus de cent mille élèves ont quitté l’enseignement public tunisien l’année dernière et autant de destins cabossés.
L’enseignement public en Tunisie : aux origines du mythe
Inspirée par le président Habib Bourguiba (1957-1987), soutenue par le Néo-Destour, et appliquée par Mahmoud Messadi, secrétaire d'Etat à l'Education nationale, la réforme de l’éducation de 1958 avait pour finalités la démocratisation et l'unification de l’enseignement tunisien, par la suppression de l'enseignement traditionnel comme de l'enseignement purement français et par la création d'un enseignement national moderne. La nouvelle politique scolaire avait marqué la mémoire collective, du moins celle de la génération née sous le « combattant suprême », répondant, dans une large mesure, aux aspirations d'un peuple de plus en plus conscient de la nécessité de l'école pour tous et pour toutes. Dans cette Tunisie indépendante, l’enseignement était obligatoire pour les deux sexes de six à douze ans, et gratuit à tous les degrés. Toute démocratisation réelle suppose qu’on enseigne les techniques et les habitudes de pensée là où les plus démunis peuvent les acquérir, c’est-à-dire à l’École.
À travers l’enseignement gratuit dispensé dans les Écoles de la République, un élève issu des classes populaires trouvait la puissance d’agir dans une situation qu’il n’a pas choisie (origine sociale). Il pouvait éprouver un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sciendi, ou du moins apprendre à lire et à écrire pour venger sa race, pour retourner l’indignité sociale en dignité. C’était le temps où les subalternes, ces garçons et filles venus des marges, avaient la chance de devenir des « transclasses » (ceux qui passent d'une classe sociale à l'autre, ndlr), des « miraculés » de la méritocratie et de l’égalité des chances.
Depuis la fin du règne de Bourguiba, destitué et proscrit en 1987 par son Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, cette politique publique qui avait fait ses preuves des décennies durant, jusqu’à marquer de son sceau le récit de l’Etat-nation tunisien ainsi que les esprits des Tunisiennes et Tunisiens, est aujourd’hui à bout de souffle, plus encore, en déliquescence, et ce malgré les tentatives de l’État de restaurer le prestige de l’enseignement public en tant que médiation apparemment neutre et socialement irréprochable, à travers laquelle l’ordre social inculque son ordre. Au fil du temps le pouvoir politique (l’étatisme autoritaire) et le pouvoir du capital, ont eu raison de la culture en Tunisie. Désormais, le service public d’éducation dans ce pays, qui a connu une dictature, une révolution et un coup de force, accentue les inégalités sociales dans la mesure où il est devenu le privilège de ceux et celles qui sont en haut de l’échelle sociale ou du moins capables d’assumer le coût exorbitant des études.
La gratuité de l’enseignement public : la fin d’un mythe
La crise économique dans laquelle est engluée la Tunisie avec une dette de plus de 100% du PIB, une inflation qui dépasse 9,1%, un taux de chômage culminant à plus de 18%, et une pénurie intermittente des produits de base sur le marché local, a porté le dernier clou dans le cercueil déjà bien abîmé de l’enseignement public, gratuit et accessible à toutes et à tous. Par gratuité, il ne faut pas entendre l’argent dépensé par les parents pour payer le matériel scolaire, vêtements, transport, cours particuliers -alors que le pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder – mais plutôt l’égalité des chances pour un fils d’ouvrier dans une région reculée et un fils de magistrat dans un quartier bourgeois d’accéder à l’École publique et d’avoir les mêmes chances de réussite.
Selon Ridha Zahrouni, président de l’Association tunisienne des parents et des élèves, « il serait insensé de parler de gratuité de l’enseignement quand le système éducatif actuel ne peut plus garantir la réussite de nos enfants malgré le coût exorbitant des études supporté par les parents. Il est d’autant plus insensé de croire encore que l’enseignement public est gratuit en Tunisie, quand le fils d’un pauvre qui habite dans un quartier populaire et le fils d’un riche qui habite dans une banlieue huppée, n’ont plus les mêmes chances de réussite du moment qu’ils intègrent l’École ».
« L’enseignement public gratuit, représenté par l’École, doit garantir la justice sociale. C’est la condition sine qua non pour donner du sens à l’École publique en tant que base de l’ascenseur social », insiste-t-il.
« Toutes ses valeurs se sont effritées au sein de l’École tunisienne (…) La réussite scolaire dépend désormais du capital économique et du capital culturel de la famille de l’élève, mais encore du potentiel social et économique du gouvernorat dans lequel il vit et poursuit sa scolarité », déplore, non sans amertume, le président de l’Association tunisienne des parents et des élèves.
Pour faire valoir son analyse, Zahrouni cite l’exemple de la capitale économique tunisienne, Sfax (sud-est) : « Quand on observe la carte de réussite aux examens nationaux, notamment au baccalauréat, on distingue nettement que le centre de gravité se situe dans la région de Sfax, dès lors on ne peut plus parler de gratuité de l’enseignement étant donné que les Sfaxiens investissent énormément dans le capital culturel de leurs enfants ».
Les parents tunisiens à quelques exceptions près investissent généralement dans l’éducation de leurs enfants, ils portent un intérêt au savoir de leurs enfants, ils rappellent à l’ordre leurs progénitures quand il est question de savoir, en somme ils ne badinent pas avec le savoir. Car dans ce savoir des enfants, ils y mettent leur propre gloire, à eux, leur sacrifice, leur propre projet d'avenir, et leur revanche sur la vie également.
L’École publique, une parodie
Pour l’universitaire et historien tunisien Lotfi Aissa, la situation de l’enseignement public est typique de pans entiers du service public en Tunisie : « Comme tous les autres secteurs, à l’image des Transports, de la Santé, - qui représentaient autrefois les fleurons de la République - l’enseignement public est en déliquescence totale ».
Cette situation est due, explique-t-il, « à un entêtement de la politique publique établie par l’État. L’État tunisien devrait comprendre que la société tunisienne a changé. La gratuité de l’enseignement public n’a pas le même sens quand l’État prend en charge 3 millions de scolarisés alors qu’auparavant il devait assurer le service public d’éducation à 500 000 élèves.
« Nous le savions, depuis les travaux de Pierre Bourdieu que l’École reproduit les élites, et l’École tunisienne ne déroge pas à cette règle, mais la nôtre se trouve dans une situation pathologique. Nous ne disposons pas d’une École « normale », qui s’acquitte de sa mission dans des conditions normales. Ce n’est pas une École publique. C’est une parodie. Nous parlons de quelque chose qui ressemble à une École publique, mais en réalité elle n’en est pas une (…) L’enseignement n’est plus inclusif, il est malheureusement beaucoup plus exclusif », a-t-il déploré.
En effet, les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron en sociologie de l’éducation ont démontré que les inégalités d’accès à l’enseignement public ainsi que les différences de résultats et parcours scolaires sont liées au milieu familial, et plus précisément au capital culturel dont disposent les parents. Les élèves qui réussissent le mieux à l’école sont les héritiers d’un capital culturel. La possession de ce capital, qui est sociologiquement une disposition, permet la maîtrise de la culture considérée comme légitime par l’École. Celle-ci traite tous les élèves comme s’ils détenaient le même capital culturel sans égard aux différences entre eux. Ainsi, le système scolaire reproduit les inégalités sociales, étant donné que les élèves les mieux « disposés » au départ, ont plus de chance d’obtenir des diplômes leur permettant de reproduire la position sociale de leurs parents.
Pour le professeur d’histoire culturelle à l’université de Tunis, si l’enseignement public en Tunisie n’est plus inclusif cela veut dire concrètement que la « machine-école » et la politique suivie par le ministère de tutelle, doivent changer de fond en comble.
Selon Lotfi Aissa, pour opérer ce changement, le ministère de l’Education doit admettre avant tout que la qualité du service de l'instruction publique devra désormais être tributaire d’une cotisation, celle des parents.
« L’École doit se charger de l’instruction de l’élève, ce qui veut dire que l’élève doit rester dans son établissement. Pour qu’il y reste, un minimum syndical de services doit être assuré à savoir : La viabilité de l’espace, les activités culturelles ou autres, la restauration (la cantine en tant que lieu de sociabilité), et les cours d’appui. Tout ceci est d’une importance capitale pour l’enseignement, mais la question qui se pose ; Avec quel argent ? ça sera avec l’argent des contribuables (agent public) », a-t-il soutenu.
L’universitaire estime que la gratuité de l’enseignement est un simulacre, avec lequel il faut en finir. « Les Allemands ont mené par le passé une enquête sociologique pour savoir combien les parents tunisiens déboursent pour garantir des études à leurs progénitures et ce que peut réellement l’École publique tunisienne. Ils sont arrivés à la conclusion que les parents d’élèves déboursent trois fois plus que ce que débourse la machine-école pour l’instruction de leurs enfants. Donc cette gratuité est un simulacre », a-t-il asserté.
Et Lotfi Aissa d’ajouter : « Cependant si vous demandez aux Tunisiens de débourser 500 dinars par an (250 dinars par semestre) pour assurer les services de qualité susmentionnés dans les établissements publics de leurs enfants, ils mettront le feu aux poudres, alors qu’ils acceptent de débourser par mois des sommes conséquentes pour les cours particuliers de leurs progénitures. Pourquoi cette schizophrénie ? ».
« Chaque formation sociale centrée sur le salut individuel, est une formation sociale décadente et impuissante », a-t-il affirmé, en allusion aux solutions individuelles face aux problèmes de l’enseignement public. Pour l’universitaire, le deal doit être partagé entre l’École publique (l’État et les enseignants) et les parents d’élèves. Et ce n’est qu’après avoir mis en place un système éducatif basé sur les cotisations, et sur la participation des familles aux services sociaux de manière générale, que nous pourrions demander des comptes à l’École publique et aux enseignants.
Lotfi Aissa estime qu’en dépit de ses maux, l’École publique reste malgré tout, une institution d’émancipation. « Nous ne pouvons pas dire in fine que celui qui n’a pas suivi un cursus scolaire est mieux que celui qui en a suivi, ne serait-ce que pour acquérir le béaba en ce qui concerne les langues, les sciences humaines et sociales etc », a-t-il insisté.
Lors de sa sortie médiatique en date du 12 septembre 2022, le ministre tunisien de l’Éducation, Fethi Sellaouti, a exposé les maux du secteur de l’enseignement public dont entre autres : la dégradation de la vie scolaire en l’absence de mécanismes de dialogue, d’écoute et d’accompagnement psychologique, social et éducatif des élèves, la hausse des phénomènes de violence, fraude, délinquance, et consommation de drogue qui menacent le vivre-ensemble, et le décrochage scolaire. Sur les 100 mille qui quittent l’École publique, on estime à 70 % ceux qui intègrent l’enseignement privé et la formation professionnelle. Le reste, soit 30%, sont livrés à eux-mêmes. Pire, 75% des élèves qui passent le concours de la 6ème année primaire et 83% de ceux de la 9ème année sont « quasi-analphabètes », selon le ministre. Une aubaine pour l’enseignement privé qui opère un mouvement de « reterritorialisation » au sens deleuzien du terme, sur l’enseignement public, « territoire perdu de la République » selon certains parents d’élèves qui n’hésitent pas à s’endetter pour pouvoir inscrire leurs enfants dans des écoles privées. En attendant les réformes, les déboires de l’enseignement public tunisien dans le contexte de crise politico-économique risquent d’accélérer la lutte des classes ou encore de faire le terreau du populisme.
Au terme de ces lignes, sachez que 300 élèves auront quitté l’École publique tunisienne et autant de rêves brisés…
Source : AA